 L’information n’a pas manqué d’être largement relayée dans la presse : ce lundi, le cours du contrat à terme du baril de pétrole WTI (West Texas Intermediate) pour livraison en mai, coté à New York, a fait une chute vertigineuse et terminé sa journée… à -37,63 dollars. Du jamais vu : en bientôt 40 ans, ce baril n’était jamais tombé sous les 10 dollars. Il était à 60 en début d’année, et encore à plus de 18 ce vendredi 17.
L’information n’a pas manqué d’être largement relayée dans la presse : ce lundi, le cours du contrat à terme du baril de pétrole WTI (West Texas Intermediate) pour livraison en mai, coté à New York, a fait une chute vertigineuse et terminé sa journée… à -37,63 dollars. Du jamais vu : en bientôt 40 ans, ce baril n’était jamais tombé sous les 10 dollars. Il était à 60 en début d’année, et encore à plus de 18 ce vendredi 17.
Évidemment, c’est sa valeur « négative » qui interpelle. D’abord, ces contrats à terme arrivaient à échéance ce mardi, ce qui signifie que leurs détenteurs devaient trouver preneur avant sous peine de ne pouvoir honorer la livraison, c’est-à-dire d’assumer un coût apparemment jugé très supérieur à celui d’une vente à perte.
 Dit autrement, les détenteurs d’un baril ont été momentanément prêts à payer 37 dollars pour s’en débarrasser. Car au-delà du contexte de forte baisse de la demande de pétrole, les investisseurs locaux ont largement anticipé la saturation toute proche des capacités de stockage américaines.
Dit autrement, les détenteurs d’un baril ont été momentanément prêts à payer 37 dollars pour s’en débarrasser. Car au-delà du contexte de forte baisse de la demande de pétrole, les investisseurs locaux ont largement anticipé la saturation toute proche des capacités de stockage américaines.
Pour les experts, ce plongeon, de courte durée et lié à l’échéance, reste cependant à relativiser. Ce contrat américain ne représente d’ailleurs pas à lui seul les « cours du pétrole ». En Europe, le baril de brent, référence mondiale, est quant à lui passé ce mardi sous les 20 dollars (l’échéance du contrat associé est en juin).
Quid du prix à la pompe ?
 Certes, partout se pose le problème plus profond de la pandémie, qui a globalement fait chuter la demande de pétrole de 30%, tandis que l’offre ne s’est pas ajustée tout de suite et que l’extraction s’est poursuivie, peinant encore à diminuer.
Certes, partout se pose le problème plus profond de la pandémie, qui a globalement fait chuter la demande de pétrole de 30%, tandis que l’offre ne s’est pas ajustée tout de suite et que l’extraction s’est poursuivie, peinant encore à diminuer.
Avant notre confinement, le contexte était déjà marqué par une baisse de la demande chinoise (premier importateur mondial), à laquelle est venue se greffer une guerre des prix entre Arabie Saoudite et Russie, qui a conduit début mars à une baisse des cours de 25%. Par ricochet, les entreprises américaines du pétrole de schiste, non rentables à ces niveaux de prix, s’en sont trouvées fragilisées.
Les plus optimistes prévoient que le redémarrage industriel en Chine tempèrera un peu la tension du moment. Selon les scénarios, la demande pourrait remonter plus ou moins lentement à partir de juin.
 A priori, tout cela n’aura pas un impact ahurissant sur les prix à la pompe. Le gazole, la semaine dernière, était à 1,2132 euro le litre. Cela fait donc 8 semaines de baisse consécutive. Mais ne rêvons pas : on ne nous paiera pas pour faire le plein. On rappelle que les taxes pèsent déjà 60% du prix à la pompe (TICPE, TVA), et qu’au surplus du prix théorique du baril, il faut ajouter les coûts du raffinage et de la distribution. Le brut en lui-même ne vaudrait qu’un quart du prix de l’essence ou du diesel.
A priori, tout cela n’aura pas un impact ahurissant sur les prix à la pompe. Le gazole, la semaine dernière, était à 1,2132 euro le litre. Cela fait donc 8 semaines de baisse consécutive. Mais ne rêvons pas : on ne nous paiera pas pour faire le plein. On rappelle que les taxes pèsent déjà 60% du prix à la pompe (TICPE, TVA), et qu’au surplus du prix théorique du baril, il faut ajouter les coûts du raffinage et de la distribution. Le brut en lui-même ne vaudrait qu’un quart du prix de l’essence ou du diesel.
Certains évaluent ainsi le « prix plancher » du litre de gazole à un euro. Cela fera évidemment une belle jambe à beaucoup d’entre nous, qui pourront se consoler en se disant que leur « sobriété » actuelle contribue un peu à cette baisse des prix…
Le secteur pétrolier touché…
 Les experts sont pour l’instant assez partagés sur l’hypothèse d’une surconsommation post-confinement d’automobilistes cherchant à profiter de l’effet d’aubaine que représente cette baisse des prix. Une hypothèse qui inquiète un peu les écologistes mais sur laquelle il est difficile de faire des prévisions.
Les experts sont pour l’instant assez partagés sur l’hypothèse d’une surconsommation post-confinement d’automobilistes cherchant à profiter de l’effet d’aubaine que représente cette baisse des prix. Une hypothèse qui inquiète un peu les écologistes mais sur laquelle il est difficile de faire des prévisions.
Difficile également d’évaluer qui, dans les grands centres urbains, préfèrera prendre sa voiture plutôt que les transports en commun… En France, la demande en carburants routiers aurait quoiqu’il en soit accusé une baisse de 70% pendant le confinement.
 Pour conclure, on évoquera un autre aspect de cette crise pétrolière : son impact sur les entreprises du secteur, à commencer par les compagnies comme Total. Celle-ci a déjà indiqué que par « solidarité », elle ne solliciterait aucune aide de l’État. Elle a annoncé qu’elle réduirait à moins de 15 milliards de dollars ses investissements cette année, soit 3 de moins que prévu, et qu’elle doublerait son plan d’économies de 400 millions d’euros.
Pour conclure, on évoquera un autre aspect de cette crise pétrolière : son impact sur les entreprises du secteur, à commencer par les compagnies comme Total. Celle-ci a déjà indiqué que par « solidarité », elle ne solliciterait aucune aide de l’État. Elle a annoncé qu’elle réduirait à moins de 15 milliards de dollars ses investissements cette année, soit 3 de moins que prévu, et qu’elle doublerait son plan d’économies de 400 millions d’euros.
Et elle a redit toute l’importance de l’enjeu, à plus long terme, de la transition énergétique. L’avenir de l’entreprise en dépend évidemment.
 Au-delà, seront affectés par cette crise les grands groupes dépendants des projets d’investissement du secteur pétrolier, comme Bourbon (services maritimes à destination de l’offshore pétrolier), TechnipFMC (gestion de projets, ingénierie et construction pour les acteurs de l’énergie), Vallourec (tubes en acier pour l’industrie et le secteur de l’énergie) et CGG (forage et exploration du sous-sol). Sans parler des fournisseurs de tous ces acteurs…
Au-delà, seront affectés par cette crise les grands groupes dépendants des projets d’investissement du secteur pétrolier, comme Bourbon (services maritimes à destination de l’offshore pétrolier), TechnipFMC (gestion de projets, ingénierie et construction pour les acteurs de l’énergie), Vallourec (tubes en acier pour l’industrie et le secteur de l’énergie) et CGG (forage et exploration du sous-sol). Sans parler des fournisseurs de tous ces acteurs…
Avec les risques associés en termes d’emploi. Bien sûr, on peut se réjouir de notre sobriété actuelle, mais il y aurait donc un revers à la médaille d’une transition énergétique un peu trop brutale…
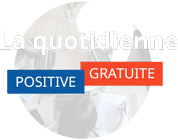




Réagissez à cet article
Vous devez être connecté(e) pour poster un commentaire