Le regroupement des 158 communes du Pays basque dans un EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale) unique est à l’ordre du jour et soulève de nombreuses interrogations. Ainsi, une réunion d'information sur les enjeux et les impacts de ce projet sur la fiscalité des entreprises est programmée mardi prochain (voir plus loin).
En attendant, PresseLib’ vous propose une petite immersion dans l’histoire des 3 provinces basques. De quoi, peut-être, inspirer la réflexion.
En route pour ce clin d’œil historique…
 FPU, FPZ, FPA, TFB, TFNB et mieux TATFNB, mais aussi CET, CFE, CVAE, TASCOM et IFER, mais encore DGF, CIF, DSR et DSU, PFIA, EFA, CAF brute et CAF nette, DCRTP, FNGIR, TBNB, ACBA, CA, CC ou CAPB, à la lecture de cette liste, non-exhaustive, sortie de la seule partie financière et fiscale de la « Présentation de l'étude réalisée sur l'exercice des compétences du futur EPCI à fiscalité propre », Georges Perec aurait pu écrire « l’EPCI, mode d’emploi ». Je ne doute pas, que si l’on remplace EPCI par PMA (pôle métropolitain assoupli) on retrouvera la même liste d’acronymes, à un CAPB près.
FPU, FPZ, FPA, TFB, TFNB et mieux TATFNB, mais aussi CET, CFE, CVAE, TASCOM et IFER, mais encore DGF, CIF, DSR et DSU, PFIA, EFA, CAF brute et CAF nette, DCRTP, FNGIR, TBNB, ACBA, CA, CC ou CAPB, à la lecture de cette liste, non-exhaustive, sortie de la seule partie financière et fiscale de la « Présentation de l'étude réalisée sur l'exercice des compétences du futur EPCI à fiscalité propre », Georges Perec aurait pu écrire « l’EPCI, mode d’emploi ». Je ne doute pas, que si l’on remplace EPCI par PMA (pôle métropolitain assoupli) on retrouvera la même liste d’acronymes, à un CAPB près.
A cette lecture il me vient à regretter ces siècles d’avant le décret du 12 janvier 1790 réunissant la Basse Navarre, avec le Labourd, et la Soule au Béarn pour former le département des Basses-Pyrénées, aujourd’hui Pyrénées-Atlantiques. Cela n’a rien à voir avec un département basque ou un rejet de nos amis béarnais, mais fait référence aux droits coutumiers qui géraient la vie des trois provinces basques et qui étaient d’une telle simplicité et modernité, que certains feraient bien de s’en inspirer.
Durant des siècles, certes chacune des provinces basques avait ses particularités, mais pour l’essentiel l’administration et la justice s’appuyaient sur les « Fors » ou droits coutumiers locaux du Pays basque, qui longtemps avant la Révolution, la Constitution et la Déclaration des Droits de l’homme offraient aux Basques, liberté et égalité, acquis qu’ils défendaient jalousement en toute fraternité.
Déjà depuis longtemps en place par tradition orale, ces coutumes furent rédigées il y a 5 siècles après l'ordonnance de Montils-les-Tours de 1454, en 1514 pour le Labourd et 1520 pour la Soule.
 Dans les provinces basques les hommes étaient de condition libre, nul servage n’y a jamais existé. Les Basques bénéficiaient de l’égalité juridique et de garanties judiciaires même supérieures à l’habeas corpus anglais de 1679, mais surtout très antérieure au reste de la France et de l’Europe qui ne connurent ces garanties qu’au XIXème siècle.
Dans les provinces basques les hommes étaient de condition libre, nul servage n’y a jamais existé. Les Basques bénéficiaient de l’égalité juridique et de garanties judiciaires même supérieures à l’habeas corpus anglais de 1679, mais surtout très antérieure au reste de la France et de l’Europe qui ne connurent ces garanties qu’au XIXème siècle.
Par exemple, en Labourd était absent tout droit féodal, et il y avait une liberté complète des hommes et des terres. Les nobles labourdins n’avaient aucune prérogative, aucun privilège, ils n’avaient aucune part au gouvernement du pays.
Comme le déclarait en 1784 Dominique Joseph Garat, député du tiers-état labourdin aux Etats généraux de 1789 : « Le laboureur, fier de ce titre qu'on lui donne et qu'il prend dans toutes les occasions comme un titre d'honneur, s'assied à la table du gentilhomme et s'y croit à sa place, et le gentilhomme pense comme lui ».
En droit familial, la femme basque était l'égale de l'homme. En témoigne l’article VI du titre IX de la Coutume de Labourd : « Le mary ne peult faire aucune vente ne aliénation des biens assignés au mariage, si la femme ne y consent, ne aussi la femme sans le consentement du mary ». Il en était de même dans l’article V du Titre 24 de la Coutume de Soule.
 Le droit successoral ne faisait, non plus, aucune différence entre les filles et les garçons. Le droit d'aînesse, sans distinction de sexe, s'imposait. L'aîné, fille ou garçon, héritait des biens qui étaient dans la famille depuis au moins deux générations, meubles et immeubles étant confondus.
Le droit successoral ne faisait, non plus, aucune différence entre les filles et les garçons. Le droit d'aînesse, sans distinction de sexe, s'imposait. L'aîné, fille ou garçon, héritait des biens qui étaient dans la famille depuis au moins deux générations, meubles et immeubles étant confondus.
On ne parlait pas d’héritier mais en basque d’etxerakoa : « celui qui est pour la maison ». Il était le gérant du patrimoine familial pendant une génération, et responsable de tous les membres de la famille, vivants et morts ; il devait notamment donner à ses frères et sœurs une situation digne de la maison et loger, nourrir et entretenir tous ceux qui ne l'avaient pas quittée. Cela permettait à plusieurs générations de vivre sous le même toit et donne toute sa force et sa symbolique à l’etxe (maison) encore aujourd’hui au Pays Basque.
L’égalité homme femme, la cohabitation et la solidarité intergénérationnel, voila encore des conceptions en avance au Pays basque.
 C’est à l’égalité que Les Droits Coutumiers du Pays basque français accordaient le plus d'importance tant en droit public qu'en droit privé ce qui en faisait une vraie démocratie. Le Biltzar du Labourd représentait le type même des assemblées démocratiques basques. La noblesse et le clergé en étaient exclus.
C’est à l’égalité que Les Droits Coutumiers du Pays basque français accordaient le plus d'importance tant en droit public qu'en droit privé ce qui en faisait une vraie démocratie. Le Biltzar du Labourd représentait le type même des assemblées démocratiques basques. La noblesse et le clergé en étaient exclus.
Il était composé des seuls hauz-apeza (maire-abbé) ou bayle des trente-cinq paroisses du pays, lesquels, élus par les maîtres de maison de leur paroisse. Ces hauz-apeza, ou par défaut un notable (jurat ou député), se réunissaient régulièrement en assemblée « Biltzar » à Ustaritz. Le président de séance lisait ensuite le texte des propositions. Le syndic donnait toutes les explications nécessaires. Les hauz-apeza dont le mandat était impératif, revenait ensuite dans leur paroisse respective, avec le texte écrit des propositions qu'ils lisaient, le dimanche suivant, aux maîtres de maison assemblés dans ce qu’on appelait « chapitalia ».
Après force discussions, ces derniers votaient sur chaque proposition. La décision était prise à la majorité des voix, chaque maison ayant une voix quelle que fut son importance.
La réponse à chaque proposition était transcrite par le greffier de la séance et rapportée à la seconde session du Biltzar qui avait lieu huit jours après la première et les décisions étaient prises à la majorité des voix avec obligation d’application. Le pouvoir de décision appartenait donc, en Labourd, encore à la veille de la Révolution, aux maîtres de maison, avec exclusion des maîtres de maisons nobles et du clergé.
 En Soule, le Grand Corps, noblesse et clergé réunis, avait une voix et le Silviet (représentation du peuple) une voix et aux Etats généraux de Basse-Navarre les trois ordres étaient représentés, chacun ayant une voix, sauf dans quelques vallées navarraises ou subsistait l'antique régime démocratique basque dans lequel les maisons étaient égales et le clergé exclu.
En Soule, le Grand Corps, noblesse et clergé réunis, avait une voix et le Silviet (représentation du peuple) une voix et aux Etats généraux de Basse-Navarre les trois ordres étaient représentés, chacun ayant une voix, sauf dans quelques vallées navarraises ou subsistait l'antique régime démocratique basque dans lequel les maisons étaient égales et le clergé exclu.
Les basques étaient comme Monsieur Jourdain et faisaient, il y a plusieurs siècles, de la démocratie participative sans le savoir.
Il est à noter que les habitants de Soule, du fait qu'ils étaient situés à l'extrémité du Royaume, entourés et enfermés par les Royaumes de Navarre et d'Aragon et le pays de Béarn, avaient le droit de porter leurs armes en tout temps pour leur défense et celle dudit pays. N’allons quand même pas jusque là.
Les Basques étaient très en avance en matière de démocratie et d’égalité et la monarchie française, respectueuse des droits acquis et des situations légitimes, n'imposait rien aux Basques sans leur consentement. En Pays basque, le dernier mot appartenait au peuple.
 En ces temps là, avant la mondialisation qui fait si peur, les basques allaient pêcher la baleine et la morue à Terre-Neuve, découvraient les Amériques avant Christophe Colomb, Juan Sebastian Elcano bouclait le premier tour du monde, Bayonne accueillait les juifs expulsés d’Espagne, les frères Elhuyar isolaient le tungstène et j’en passe.
En ces temps là, avant la mondialisation qui fait si peur, les basques allaient pêcher la baleine et la morue à Terre-Neuve, découvraient les Amériques avant Christophe Colomb, Juan Sebastian Elcano bouclait le premier tour du monde, Bayonne accueillait les juifs expulsés d’Espagne, les frères Elhuyar isolaient le tungstène et j’en passe.
Démocratie, fiscalité raisonnable, finances équilibrées, recherche, développement à l’international, accueil et intégration, tout cela avec trois provinces, Labourd, Basse Navarre et Soule.
À l’heure où certains cherchent une alternative au projet d’EPCI pourquoi ne pas s’inspirer de ce qui a fonctionné durant des siècles au Pays basque et qui semble déjà recueillir l’approbation de certains.
Souvent dans la vie on cherche ailleurs ce que l’on a sous le nez.
 Sources :
Sources :
- Les fors basques et les droits de l'homme
- Les assemblées provinciales du Pays Basque français sous l'Ancien Régime
- Maïté Lafourcade : Professeur émérite d'Histoire du droit, Université de Pau et des Pays de l'Adour, Faculté pluridisciplinaire de Bayonne-Anglet-Biarritz
- Le Bilçar d’Ustaritz au Pays du labourd - P. Yturbide
 Rendez-vous le mardi 22 mars…
Rendez-vous le mardi 22 mars…
Une réunion d'information sur les enjeux et les impacts de la refonte des intercommunalités du Pays basque sur la fiscalité des entreprises est organisée le mardi 22 mars à 19h, salle Harri Xuri à Louhossoa.
Elle sera animée par Eric Julla, directeur général du cabinet Ressources Consultants Finances.
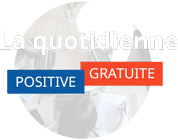





Réagissez à cet article
Vous devez être connecté(e) pour poster un commentaire