Quand on pense à l’eau, on imagine volontiers une rivière qui serpente, un lac où l’on se baigne ou l’océan qui borde nos côtes. Pourtant, une grande partie de la ressource en eau se cache sous terre, dans d’immenses réservoirs invisibles appelés nappes phréatiques. Le sud-ouest de la France n’échappe pas à cette règle : sous le Bassin aquitain, véritable mille feuille géologique coincé entre Pyrénées, Massif central et Atlantique, s’étendent des couches de roches qui abritent des eaux vieilles parfois de plusieurs dizaines de milliers d’années.
Ces nappes profondes, protégées par des couches imperméables, contiennent une eau d’une qualité exceptionnelle, souvent pure et peu vulnérable aux pollutions de surface. C’est cette singularité qui explique leur importance stratégique : elles fournissent à la fois de l’eau potable à des centaines de milliers d’habitants, de l’eau thermale prisée pour ses vertus, mais aussi des ressources pour l’agriculture et l’industrie. Autrement dit, elles sont la face cachée mais indispensable du grand cycle de l’eau.
Quand l’eau ne se renouvelle pas
Contrairement aux nappes dites « libres », qui se rechargent chaque année avec les pluies, les nappes profondes dites « captives » n’ont pas ce luxe. Elles se remplissent extrêmement lentement, à une échelle de temps qui dépasse largement une vie humaine. Chaque prélèvement, qu’il serve à alimenter un village ou à chauffer une piscine thermale, vient donc puiser dans une réserve limitée. Depuis les années 1990, les scientifiques observent une baisse inquiétante des niveaux d’eau, parfois de plus de vingt mètres.
Le défi est clair : il faut apprendre à gérer cette ressource comme un capital précieux, dont on ne doit pas dépenser les intérêts plus vite qu’ils ne se régénèrent. Car une surexploitation risquerait de rendre certains aquifères totalement inutilisables, une perte irréversible pour les générations futures.
C’est pour éviter ce scénario que s’est mise en place une démarche collective. Les collectivités locales, les services de l’État, les syndicats d’eau, mais aussi les acteurs économiques et associatifs ont décidé de travailler ensemble. Leur objectif : trouver un équilibre entre les besoins actuels (boire, cultiver, chauffer, produire) et la préservation à long terme de la ressource.
En mars 2025, un SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux) spécifique aux nappes souterraines de Gascogne a été officiellement lancé. Son périmètre est vaste : il couvre la totalité des Landes et du Gers, ainsi que le nord des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. À terme, ce SAGE définira un véritable « mode d’emploi » pour l’utilisation de l’eau souterraine, avec des règles communes et des objectifs partagés.
Une CLE pour garder le cap
Pour piloter ce chantier, une Commission locale de l’eau (CLE) a été installée le 25 juin 2025. Elle réunit élus, usagers, associations, représentants de l’État et acteurs économiques. À sa tête, Bernard Labadie, maire d’Eyres-Moncube et vice-président du syndicat d’eau potable du Marseillon et du Tursan. Pendant six ans, il aura pour mission de coordonner les réflexions et de veiller à ce que chacun trouve sa place dans la gestion de ce bien commun.
L’Institution Adour, désignée comme structure porteuse, assure le pilotage technique et administratif de cette démarche, dont l’élaboration devrait durer cinq ans. L’idée est simple : avancer ensemble, dans un esprit de concertation, pour que les décisions prises ne soient pas imposées d’en haut mais partagées et comprises par tous.
Si la gestion des nappes profondes est si cruciale, c’est parce que certains territoires n’ont tout simplement pas d’alternative. Dans le Tursan ou à Nogaro, par exemple, 100 % de l’eau potable provient de la nappe des sables infra-molassiques. De même, des communes comme Peyrehorade, Roquefort ou Banos dépendent exclusivement de nappes du Crétacé. Au total, près de 70 000 habitants n’ont d’autre choix que de puiser leur eau dans ces réservoirs anciens.
Ces nappes ne servent pas seulement à remplir nos verres : elles font vivre tout un tissu économique. Le thermalisme landais et gersois, par exemple, repose sur les qualités particulières de ces eaux souterraines. L’agriculture, bien que consommatrice modeste, y recourt ponctuellement. Quant à l’industrie, elle y puise pour la géothermie ou l’embouteillage d’eaux minérales.
Quand le gaz se mêle à l’eau
Les nappes profondes ne servent pas uniquement à l’alimentation en eau. Depuis les années 1950, elles sont aussi utilisées pour stocker du gaz naturel. Deux sites stratégiques, à Lussagnet et Izaute (Landes et Gers), utilisent les propriétés des couches géologiques pour emmagasiner du gaz l’été, puis le restituer l’hiver lorsque la consommation est plus forte.
Ce système a des conséquences directes sur les nappes : les injections et soutirages de gaz font varier le niveau d’eau de plusieurs dizaines de mètres dans certains forages. Teréga, l’opérateur, accompagne les usagers pour limiter l’impact, en adaptant par exemple les pompes des captages d’eau potable. Ces stockages restent essentiels à la sécurité énergétique nationale, mais leur interaction avec l’eau souterraine illustre bien la complexité de la gestion de ce patrimoine commun.
Le SAGE des eaux souterraines de Gascogne n’en est qu’à ses débuts. Les premières étapes consisteront à dresser un état des lieux précis, puis à fixer des objectifs de gestion et des règles adaptées. Un travail de fourmi, qui doit concilier science, technique et réalité du terrain.
Mais derrière les sigles et les procédures se cache une réalité simple : l’eau souterraine est une ressource limitée, ancienne et précieuse. La préserver, c’est garantir l’accès à l’eau pour les habitants, la survie de certains territoires et la transmission d’un héritage naturel inestimable.
En filigrane, c’est aussi la question de notre rapport à l’eau qui se pose. Nous avons longtemps considéré qu’elle était abondante et gratuite. Or, l’eau souterraine nous rappelle que certaines ressources sont rares, fragiles, et qu’elles se comptent en milliers d’années.
Sébastien Soumagnas
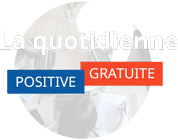


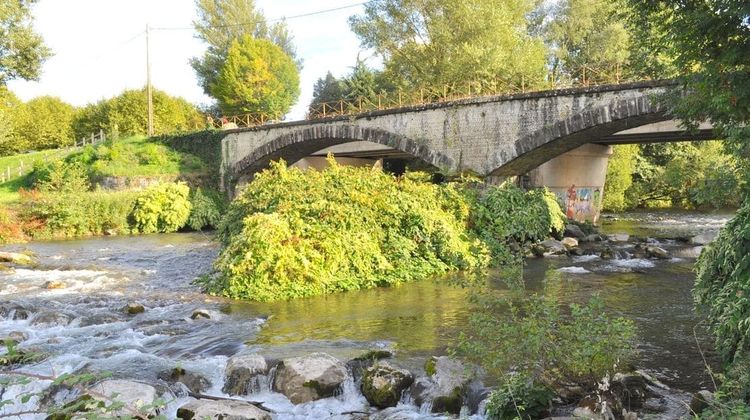

Réagissez à cet article
Vous devez être connecté(e) pour poster un commentaire