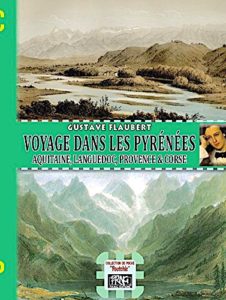 Il paraît que Gustave Flaubert était loin d’être le plus brillant élève de son lycée. Indiscipliné, il en fut renvoyé en 1839 pour avoir refusé de se plier à une punition collective, conséquence d’un grand chahut à l’étude, et ce ne fut apparemment pas sans mal qu’il obtint son baccalauréat l’année suivante. En récompense, ses parents lui offrirent un voyage de sa Normandie natale jusqu’en Corse.
Il paraît que Gustave Flaubert était loin d’être le plus brillant élève de son lycée. Indiscipliné, il en fut renvoyé en 1839 pour avoir refusé de se plier à une punition collective, conséquence d’un grand chahut à l’étude, et ce ne fut apparemment pas sans mal qu’il obtint son baccalauréat l’année suivante. En récompense, ses parents lui offrirent un voyage de sa Normandie natale jusqu’en Corse.
Du 22 août au 1er novembre 1840, accompagné du docteur Jules Cloquet, de sa sœur Lise Cloquet et de l’abbé Stéphani, le jeune bachelier passa par Bordeaux, Bayonne, Fontarabie, Pau, Bagnères-de-Luchon, Toulouse, Carcassonne, Narbonne, Nîmes, Arles et Marseille, avant de gagner l’Île de Beauté, qu’il traversa d’ouest en est, d’Ajaccio à Bastia via Corte. Pendant son périple et aussitôt après, il tint un petit journal.
 Ces impressions de voyage ne parurent qu’après la mort de Flaubert. Leur première édition remonte à 1910, à la suite de « Par les Champs et par les Grèves » (texte rédigé à 4 mains avec Maxime Du Camp et relatant leur expédition de 1847 en Bretagne), au sein des œuvres complètes publiées par le libraire-éditeur parisien Louis Conard.
Ces impressions de voyage ne parurent qu’après la mort de Flaubert. Leur première édition remonte à 1910, à la suite de « Par les Champs et par les Grèves » (texte rédigé à 4 mains avec Maxime Du Camp et relatant leur expédition de 1847 en Bretagne), au sein des œuvres complètes publiées par le libraire-éditeur parisien Louis Conard.
Aujourd’hui, on les trouve généralement rééditées seules ou à la suite d’une autre œuvre de jeunesse de l’auteur, les « Mémoires d’un fou », qu’elles accompagnent par exemple dans l’édition Folio, dont la présentation vante « le jaillissement, le charme, le talent déjà adulte du jeune Flaubert ».
 Outre que ce texte nous parle d’une manière déjà toute flaubertienne du bassin de l’Adour, il nous donnera donc une petite idée du niveau de la langue d’un bachelier dissipé des années 1840, non encore promis à la postérité que lui assureront plus tard ses romans-phares Madame Bovary (1857), Salammbô (1862) et L’Éducation sentimentale (1869), mais au style et à l’ironie déjà bien affirmés.
Outre que ce texte nous parle d’une manière déjà toute flaubertienne du bassin de l’Adour, il nous donnera donc une petite idée du niveau de la langue d’un bachelier dissipé des années 1840, non encore promis à la postérité que lui assureront plus tard ses romans-phares Madame Bovary (1857), Salammbô (1862) et L’Éducation sentimentale (1869), mais au style et à l’ironie déjà bien affirmés.
De Bordeaux à l’Adour…
Oui, le jeune Flaubert a déjà toute sa plume, mais il est aussi très intéressant de le voir qui se cherche encore, qui hésite entre les canons de la littérature de voyage et une volonté de s’en démarquer : « Et puis, à quoi bon tout dire ? N’est-il pas doux au contraire de conserver dans le recoin du cœur des choses inconnues, des souvenirs que nul autre ne peut s’imaginer et que vous évoquez les jours sombres comme aujourd’hui, dont la réapparition vous illumine de joie et vous charmera comme dans un rêve ? Quand je décrirais aujourd’hui la vallée de Campan et Bagnères-de-Bigorre, quand j’aurais parlé de la culture, des exploitations, des chemins et des voitures, des grottes et des cascades, des ânes et des femmes, après ? après ? Est-ce que j’aurai satisfait un désir, exprimé une idée, écrit un mot de vrai ? »
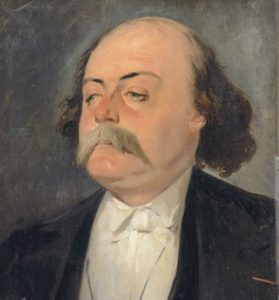 Comme dans les notes de Stendhal, les choses sérieuses commencent à Bordeaux : « Ce qu’on appelle ordinairement un bel homme est une chose assez bête ; jusqu’à présent, j’ai peur que Bordeaux ne soit une belle ville. Larges rues, places ouvertes, beaucoup de mouchoirs sur des têtes brunes, telle est la phrase synthétique dans laquelle je la résume avant d’en savoir davantage. Il me faut pour que je l’aime quelque chose de plus que son pont, que les pantalons blancs de ses commerçants, que ses rues alignées et son port qui est le type du port. Il n’y fait, selon moi, ni assez chaud ni assez froid ; il n’y a rien d’incisif et d’accentué : c’est un Rouen méridional, avec une Garonne aux eaux bourbeuses ».
Comme dans les notes de Stendhal, les choses sérieuses commencent à Bordeaux : « Ce qu’on appelle ordinairement un bel homme est une chose assez bête ; jusqu’à présent, j’ai peur que Bordeaux ne soit une belle ville. Larges rues, places ouvertes, beaucoup de mouchoirs sur des têtes brunes, telle est la phrase synthétique dans laquelle je la résume avant d’en savoir davantage. Il me faut pour que je l’aime quelque chose de plus que son pont, que les pantalons blancs de ses commerçants, que ses rues alignées et son port qui est le type du port. Il n’y fait, selon moi, ni assez chaud ni assez froid ; il n’y a rien d’incisif et d’accentué : c’est un Rouen méridional, avec une Garonne aux eaux bourbeuses ».
 En ce début de voyage, Gustave se montre assez grognon. Il avait d’ailleurs un peu rechigné avant de partir. À distance, sa mère s’inquiète de sa santé.
En ce début de voyage, Gustave se montre assez grognon. Il avait d’ailleurs un peu rechigné avant de partir. À distance, sa mère s’inquiète de sa santé.
Mais l’air du Midi va finalement lui faire le plus grand bien. Ses visites lui inspirent déjà de brillants passages : « On nous vante le bonheur matériel du monde moderne et la douceur de l’enchâssement social, et, reportant sur le passé un immense regard de pitié, nous faisons les capables et les forts, nous nous rengorgeons dans notre linge frais et dans nos maisons bien fermées, qui sont plus vides, hélas, que les caravansérails délabrés de l’Orient, abandonnés qu’ils sont à tous les vents qui dessèchent, où nous habitons seuls, sans dieux et sans fées, sans passé et sans avenir, sans orgueil de nos ancêtres, sans espoir religieux dans notre postérité, sans gloires ni armoiries sur nos portes, ni sans christ au chevet ».
 Tout au long du texte, nous entrevoyons déjà, chez le futur auteur de Salammbô, ce goût prononcé pour un certain exotisme : « Un palmier pour nous c’est toute l’Inde, tout l’Orient ; sous le palmier l’éléphant paré d’or bondit et balance au son des tambourins, la bayadère danse sous son ombrage, l’encens fume et monte dans ses rameaux pendant que le brahme assis chante les louanges de Brahma et des Dieux », écrit-il à la fin du voyage. Flaubert rêve déjà d’explorations plus lointaines.
Tout au long du texte, nous entrevoyons déjà, chez le futur auteur de Salammbô, ce goût prononcé pour un certain exotisme : « Un palmier pour nous c’est toute l’Inde, tout l’Orient ; sous le palmier l’éléphant paré d’or bondit et balance au son des tambourins, la bayadère danse sous son ombrage, l’encens fume et monte dans ses rameaux pendant que le brahme assis chante les louanges de Brahma et des Dieux », écrit-il à la fin du voyage. Flaubert rêve déjà d’explorations plus lointaines.
Une Espagne rêvée…
 En attendant, nous arrivons dans les pays de l’Adour : « De Bordeaux à Bayonne, vous passez dans un pays qui est dit les Landes, quoiqu’il soit, sans contredit, bien supérieur au Poitou et à la Guyenne. Vous allez au milieu de pins clairsemés ; çà et là une maison, des attelages de bœufs qui traînent un petit chariot dans lequel est assise une femme couverte d’un large chapeau de paille. À Dax, le bois s’épaissit, et jusqu’à Bayonne la route est charmante. On retrouve plus de fraîcheur et d’herbe ; les petites collines boisées qui se succèdent les unes aux autres annoncent enfin qu’on va voir les montagnes et on les voit enfin se déployer dans le ciel à grandes masses blanches, qui tout à coup saillissent à l’horizon. Je ne sais quel espoir vous prend alors, l’ennui des plaines blanches du Midi vous quitte, il vous semble que le vent de la montagne va souffler jusqu’à vous, et quand vous entrez dans Bayonne, l’enchantement commence ».
En attendant, nous arrivons dans les pays de l’Adour : « De Bordeaux à Bayonne, vous passez dans un pays qui est dit les Landes, quoiqu’il soit, sans contredit, bien supérieur au Poitou et à la Guyenne. Vous allez au milieu de pins clairsemés ; çà et là une maison, des attelages de bœufs qui traînent un petit chariot dans lequel est assise une femme couverte d’un large chapeau de paille. À Dax, le bois s’épaissit, et jusqu’à Bayonne la route est charmante. On retrouve plus de fraîcheur et d’herbe ; les petites collines boisées qui se succèdent les unes aux autres annoncent enfin qu’on va voir les montagnes et on les voit enfin se déployer dans le ciel à grandes masses blanches, qui tout à coup saillissent à l’horizon. Je ne sais quel espoir vous prend alors, l’ennui des plaines blanches du Midi vous quitte, il vous semble que le vent de la montagne va souffler jusqu’à vous, et quand vous entrez dans Bayonne, l’enchantement commence ».
 Le jeune Flaubert semble plus conquis que son devancier. Au-delà des landes, il se sent enfin dans un autre monde, loin de cette Normandie qui l’étouffe, et son ton se fait plus poétique et onirique : « L’Adour est un beau fleuve qu’il faut voir comme je l’ai vu, quand le soleil couchant assombrit ses flots azurés, que son courant, calme le soir, glisse le long des rives couvertes d’herbes. Aux allées marines où je me promenais hier après la pluie, l’air était doux, on entendait à deux lieues de là le bruit sourd de la mer sur les roches ; à gauche il y a une prairie verte où paissaient les bœufs ».
Le jeune Flaubert semble plus conquis que son devancier. Au-delà des landes, il se sent enfin dans un autre monde, loin de cette Normandie qui l’étouffe, et son ton se fait plus poétique et onirique : « L’Adour est un beau fleuve qu’il faut voir comme je l’ai vu, quand le soleil couchant assombrit ses flots azurés, que son courant, calme le soir, glisse le long des rives couvertes d’herbes. Aux allées marines où je me promenais hier après la pluie, l’air était doux, on entendait à deux lieues de là le bruit sourd de la mer sur les roches ; à gauche il y a une prairie verte où paissaient les bœufs ».
 Sur la plage de Biarritz lui arrive une première aventure imprévue. Il va plonger en pantalon dans l’océan et nager vainement au secours d’hommes en train de se noyer. Il narre gravement cet épisode, puis pousse ensuite jusqu’à l’Espagne où, comme Stendhal avant lui, il se sent enfin dans son élément. Il prend le temps de décrire Fontarabie, « ville toute en ruines », avec sa dépaysante église débarrassée de « ce jour insultant des temples du Midi » : « Point d’ornements à l’extérieur, des grands murs droits comme à Saint-Jean-de-Luz qui ressemble aussi à l’Espagne. Nous y étions entrés le même jour, le matin ; on y disait une messe des morts ; il y avait peu de monde, quelques femmes toutes entourées de voiles et à une grande distance les unes des autres se tenaient au milieu de l’église, agenouillées séparément sur des tapis noirs et la tête baissée ». La mort, sous tous ses aspects, fascine visiblement notre adolescent tourmenté.
Sur la plage de Biarritz lui arrive une première aventure imprévue. Il va plonger en pantalon dans l’océan et nager vainement au secours d’hommes en train de se noyer. Il narre gravement cet épisode, puis pousse ensuite jusqu’à l’Espagne où, comme Stendhal avant lui, il se sent enfin dans son élément. Il prend le temps de décrire Fontarabie, « ville toute en ruines », avec sa dépaysante église débarrassée de « ce jour insultant des temples du Midi » : « Point d’ornements à l’extérieur, des grands murs droits comme à Saint-Jean-de-Luz qui ressemble aussi à l’Espagne. Nous y étions entrés le même jour, le matin ; on y disait une messe des morts ; il y avait peu de monde, quelques femmes toutes entourées de voiles et à une grande distance les unes des autres se tenaient au milieu de l’église, agenouillées séparément sur des tapis noirs et la tête baissée ». La mort, sous tous ses aspects, fascine visiblement notre adolescent tourmenté.
 Aussitôt après Pau, nous entrons dans le vif du sujet : « Si on n’avait devant soi les pics des Pyrénées, on trouverait superbes ces montagnes d’avant-poste, ces paysages si pleins de fraîcheur, ces vallées qui ont l’air d’une corbeille de marbre tapissée d’herbes. J’ai été à pied de Assat aux Eaux-Chaudes, le long du gave qui roulait au fond sous des touffes d’arbres. La route serpente le long d’un côté, suspendue aux rochers, comme un grand lézard blanc qui en suivrait tous les contours ».
Aussitôt après Pau, nous entrons dans le vif du sujet : « Si on n’avait devant soi les pics des Pyrénées, on trouverait superbes ces montagnes d’avant-poste, ces paysages si pleins de fraîcheur, ces vallées qui ont l’air d’une corbeille de marbre tapissée d’herbes. J’ai été à pied de Assat aux Eaux-Chaudes, le long du gave qui roulait au fond sous des touffes d’arbres. La route serpente le long d’un côté, suspendue aux rochers, comme un grand lézard blanc qui en suivrait tous les contours ».
Les merveilles des Pyrénées…
 L’expédition se poursuit à Cauterets, au lac de Gaube, avec « sa teinte vert de gris » qui « le fait confondre un instant avec l’herbe que vous foulez », avec son eau « si calme qu’on dirait une grande glace verte », et puis en arrière-plan « le Vignemale, dont les sommets sont couverts de neige, de sorte que le lac se trouve encaissé dans les montagnes, si ce n’est du côté où vous êtes ». Déjà expert dans les codes de la littérature de voyage, Flaubert nous amuse en ironisant sur les remarques laissées par ses prédécesseurs sur le livre d’or du site, puis glisse une anecdote sur un mot qu’aurait eu Chateaubriand sur place.
L’expédition se poursuit à Cauterets, au lac de Gaube, avec « sa teinte vert de gris » qui « le fait confondre un instant avec l’herbe que vous foulez », avec son eau « si calme qu’on dirait une grande glace verte », et puis en arrière-plan « le Vignemale, dont les sommets sont couverts de neige, de sorte que le lac se trouve encaissé dans les montagnes, si ce n’est du côté où vous êtes ». Déjà expert dans les codes de la littérature de voyage, Flaubert nous amuse en ironisant sur les remarques laissées par ses prédécesseurs sur le livre d’or du site, puis glisse une anecdote sur un mot qu’aurait eu Chateaubriand sur place.
 Mais pour l’auteur, la palme pyrénéenne semble devoir revenir à Gavarnie, ce qu’il a « vu de plus beau » jusque-là : « Tout s’oublie vite quand on arrive dans le cirque de Gavarnie. C’est une enceinte de deux lieues de diamètre, enfermée dans un cercle de montagnes dont tous les sommets sont couverts de neige et du fond de laquelle tombe une cascade. A gauche, la brèche de Roland et la carrière de marbre, et le sol sur lequel on s’avance, et qui de loin semblait uni, monte par une pente si raide qu’il faut s’aider des mains et des genoux pour arriver au pied de la cascade ; la terre glisse sous vos pas, les roches roulent et s’en vont dans le gave, la cascade mugit et vous inonde de sa poussière d’eau ».
Mais pour l’auteur, la palme pyrénéenne semble devoir revenir à Gavarnie, ce qu’il a « vu de plus beau » jusque-là : « Tout s’oublie vite quand on arrive dans le cirque de Gavarnie. C’est une enceinte de deux lieues de diamètre, enfermée dans un cercle de montagnes dont tous les sommets sont couverts de neige et du fond de laquelle tombe une cascade. A gauche, la brèche de Roland et la carrière de marbre, et le sol sur lequel on s’avance, et qui de loin semblait uni, monte par une pente si raide qu’il faut s’aider des mains et des genoux pour arriver au pied de la cascade ; la terre glisse sous vos pas, les roches roulent et s’en vont dans le gave, la cascade mugit et vous inonde de sa poussière d’eau ».
 Puisqu’on n’avait pas encore beaucoup parlé des Pyrénées cette année, on peut bien s’aventurer avec Flaubert jusqu’au port de Vénasque : « À votre gauche vous apercevez successivement quatre lacs enchâssés dans des rochers, calmes comme s’ils étaient gelés ; point de plantes, pas de mousse, rien ; les teintes sont plus vertes et plus livides sur les bords et toute la surface est plutôt noire que bleue. Rien n’est triste comme la couleur de ces eaux qui ont l’air cadavéreuses et violacées et qui sont plus immobiles et plus nues que les rochers qui les entourent. De temps en temps on croit être arrivé au haut de la montagne, mais tout à coup elle fait un détour, semble s’allonger, comme courir devant vous à mesure que vous montez sur elle ; vous vous arrêtez pourtant, croyant que la montagne vous barre le passage et vous empêche d’aller plus avant, que tout est fini, et qu’il n’y a plus qu’à se retourner pour voir la France, mais voilà que subitement, et comme si la montagne se déchirait, la Maladetta surgit devant vous. À gauche toutes les montagnes de l’Auvergne, à droite la Catalogne, l’Espagne là devant vous, et l’esprit peut courir jusqu’à Séville, jusqu’à Tolède, dans I’AIhambra, jusqu’à Cordoue, jusqu’à Cadix, escaladant les montagnes et volant avec les aigles qui planent sur nos têtes, ainsi que d’une plage de l’Océan l’œil plonge dans l’horizon, suit le sillage des navires et voit de là, dans la lointaine Amérique, les bananiers en fleurs, et les hamacs suspendus aux platanes des forêts vierges ». Il y a décidément du Flaubert dans les admirables descriptions de ce jeune bachelier…
Puisqu’on n’avait pas encore beaucoup parlé des Pyrénées cette année, on peut bien s’aventurer avec Flaubert jusqu’au port de Vénasque : « À votre gauche vous apercevez successivement quatre lacs enchâssés dans des rochers, calmes comme s’ils étaient gelés ; point de plantes, pas de mousse, rien ; les teintes sont plus vertes et plus livides sur les bords et toute la surface est plutôt noire que bleue. Rien n’est triste comme la couleur de ces eaux qui ont l’air cadavéreuses et violacées et qui sont plus immobiles et plus nues que les rochers qui les entourent. De temps en temps on croit être arrivé au haut de la montagne, mais tout à coup elle fait un détour, semble s’allonger, comme courir devant vous à mesure que vous montez sur elle ; vous vous arrêtez pourtant, croyant que la montagne vous barre le passage et vous empêche d’aller plus avant, que tout est fini, et qu’il n’y a plus qu’à se retourner pour voir la France, mais voilà que subitement, et comme si la montagne se déchirait, la Maladetta surgit devant vous. À gauche toutes les montagnes de l’Auvergne, à droite la Catalogne, l’Espagne là devant vous, et l’esprit peut courir jusqu’à Séville, jusqu’à Tolède, dans I’AIhambra, jusqu’à Cordoue, jusqu’à Cadix, escaladant les montagnes et volant avec les aigles qui planent sur nos têtes, ainsi que d’une plage de l’Océan l’œil plonge dans l’horizon, suit le sillage des navires et voit de là, dans la lointaine Amérique, les bananiers en fleurs, et les hamacs suspendus aux platanes des forêts vierges ». Il y a décidément du Flaubert dans les admirables descriptions de ce jeune bachelier…
Du Languedoc à la Corse…
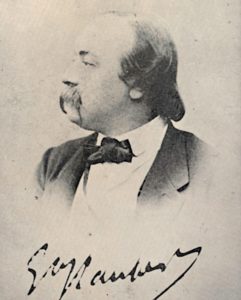 À Toulouse, l’impertinence du futur étudiant en droit refait surface : « Ce que je pourrais dire ici de Saint-Sernin serait le pendant de Saint-Bertrand de Comminges, ratatouille de styles qui figurerait bien en face de l’autre, flanqué de cornichons et de réflexions esthétiques ». Voilà qui tranche un peu avec le ton des notes de Stendhal… On se promène ensuite en Languedoc, « pays de soulas, de vie douce et facile ; à Carcassonne, à Narbonne, sur toute la ligne de Toulouse à Marseille, ce sont de grandes prairies couvertes de raisins qui jonchent la terre. Çà et là des masses grises d’oliviers, comme des pompons de soie ; au fond, les montagnes de l’Hérault. L’air est chaud, et le vent du Sud fait sourire de bien-être. Les gens sont doux et polis. Pays ouvert et qui reçoit grassement l’étranger, le Languedoc n’offre point de saillies bien tranchées ni dans les types, ni dans le costume, ni dans l’idiome. Tout le Midi en effet y a passé et y a laissé quelque chose : Romains, Goths, Francs du Nord aussi, dans la guerre des Albigeois, Espagnols à leur tour, tous y sont venus et y ont chassé sans doute tout élément national et primitif ; la nationalité s’est retirée plus haute et plus sombre dans les montagnes, ou plus acariâtre et violente dans la Provence ».
À Toulouse, l’impertinence du futur étudiant en droit refait surface : « Ce que je pourrais dire ici de Saint-Sernin serait le pendant de Saint-Bertrand de Comminges, ratatouille de styles qui figurerait bien en face de l’autre, flanqué de cornichons et de réflexions esthétiques ». Voilà qui tranche un peu avec le ton des notes de Stendhal… On se promène ensuite en Languedoc, « pays de soulas, de vie douce et facile ; à Carcassonne, à Narbonne, sur toute la ligne de Toulouse à Marseille, ce sont de grandes prairies couvertes de raisins qui jonchent la terre. Çà et là des masses grises d’oliviers, comme des pompons de soie ; au fond, les montagnes de l’Hérault. L’air est chaud, et le vent du Sud fait sourire de bien-être. Les gens sont doux et polis. Pays ouvert et qui reçoit grassement l’étranger, le Languedoc n’offre point de saillies bien tranchées ni dans les types, ni dans le costume, ni dans l’idiome. Tout le Midi en effet y a passé et y a laissé quelque chose : Romains, Goths, Francs du Nord aussi, dans la guerre des Albigeois, Espagnols à leur tour, tous y sont venus et y ont chassé sans doute tout élément national et primitif ; la nationalité s’est retirée plus haute et plus sombre dans les montagnes, ou plus acariâtre et violente dans la Provence ».
 Après d’autres beaux passages sur Nîmes, Arles et leurs arènes, nous arrivons à Marseille et sommes prêts à embarquer pour la Corse. Mais avant cela, petite leçon de vacances : « Si j’ai maudit les bains de Bordeaux, je bénis ceux de Marseille. Quand j’y fus, c’était le soir, au soleil couchant ; il y avait peu de monde, j’avais toute la mer pour moi. Le grand calme qu’il faisait est des plus agréables pour nager, et le flot vous berce tout doucement avec un grand charme. Quelquefois j’écartais les quatre membres et je restais suspendu sur l’eau sans rien faire, regardant le fond de la mer tout tapissé de varechs, d’herbes vertes qui se remuent lentement, suivant le roulis qui les agite lentement comme une brise ».
Après d’autres beaux passages sur Nîmes, Arles et leurs arènes, nous arrivons à Marseille et sommes prêts à embarquer pour la Corse. Mais avant cela, petite leçon de vacances : « Si j’ai maudit les bains de Bordeaux, je bénis ceux de Marseille. Quand j’y fus, c’était le soir, au soleil couchant ; il y avait peu de monde, j’avais toute la mer pour moi. Le grand calme qu’il faisait est des plus agréables pour nager, et le flot vous berce tout doucement avec un grand charme. Quelquefois j’écartais les quatre membres et je restais suspendu sur l’eau sans rien faire, regardant le fond de la mer tout tapissé de varechs, d’herbes vertes qui se remuent lentement, suivant le roulis qui les agite lentement comme une brise ».
 Près de deux siècles plus tard, on ne peut s’empêcher de rapprocher les lignes que Flaubert consacre à la Corse de celles du Mérimée de Colomba et de Mateo Falcone. On n’est pas chauvin : le volet corse de ce voyage flaubertien est peut-être le plus vivant et réussi, notamment dans le rendu des mœurs locales : « Un Corse ne voyage jamais sans être armé, soit par prudence ou par habitude. On porte le poignard soit attaché dans le pantalon, mis dans la poche de la veste, ou glissé dans la manche ; jamais on ne s’en sépare, pas même à la ville, pas même à table. Dans un grand dîner à la préfecture et où se trouvait réuni presque tout le conseil général, on m’a assuré que pas un des convives n’était sans son stylet. Le cocher qui nous a conduits à Bogogna tenait un grand pistolet chargé sous le coussin de sa voiture. Tous les bergers de la Corse manquent plutôt de chemise blanche que de lame affilée ».
Près de deux siècles plus tard, on ne peut s’empêcher de rapprocher les lignes que Flaubert consacre à la Corse de celles du Mérimée de Colomba et de Mateo Falcone. On n’est pas chauvin : le volet corse de ce voyage flaubertien est peut-être le plus vivant et réussi, notamment dans le rendu des mœurs locales : « Un Corse ne voyage jamais sans être armé, soit par prudence ou par habitude. On porte le poignard soit attaché dans le pantalon, mis dans la poche de la veste, ou glissé dans la manche ; jamais on ne s’en sépare, pas même à la ville, pas même à table. Dans un grand dîner à la préfecture et où se trouvait réuni presque tout le conseil général, on m’a assuré que pas un des convives n’était sans son stylet. Le cocher qui nous a conduits à Bogogna tenait un grand pistolet chargé sous le coussin de sa voiture. Tous les bergers de la Corse manquent plutôt de chemise blanche que de lame affilée ».
Triste retour au pays…
 La maison natale de Napoléon a Ajaccio
La maison natale de Napoléon a Ajaccio
On se régale des remarques de Flaubert, qu’on pourrait citer à l’envi : « II ne faut point juger les mœurs de la Corse avec nos petites idées européennes. Ici un bandit est ordinairement le plus honnête homme du pays et il rencontre dans l’estime et la sympathie populaire tout ce que son exil lui a fait quitter de sécurité sociale. Un homme tue son voisin en plein jour sur la place publique, il gagne le maquis et disparaît pour toujours. Hors un membre de sa famille, qui correspond avec lui, personne ne sait plus ce qu’il est devenu. Ils vivent ainsi dix ans, quinze ans, quelquefois vingt ans. Quand ils ont fini leur contumace ils rentrent chez eux comme des ressuscités, ils reprennent leur ancienne façon de vivre, sans que rien de honteux ne soit attaché à leur nom ».
Nous partons d’Ajaccio, où nous visitons avec Flaubert la maison natale de Napoléon, puis traversons le pays pour rejoindre Bastia, mal vue du reste de l’île. Entre les deux, le voyage s’effectue aussi bien dans l’espace que dans le temps : « Tout cela était si loin de la France, si loin du siècle, resté à une époque que nous rêvons maintenant dans les livres, et je me demandais si après tout, quand on voyagera en diligence, quand il y aura au lieu de ces maisons délabrées des restaurants à la carte, et quand tout ce pays pauvre sera devenu misérable grâce à la cupidité qu’on y introduira, si tout cela enfin vaudra bien mieux ».
 La Corse inspire bien d’autres belles réflexions à l’auteur, telles que celle-ci : « La misère dans le Nord n’a rien de bien choquant, le ciel est gris ; toute la nature est lugubre ; mais ici, quand le soleil répand tant de splendeur et de vie rayonnante, les couleurs sombres sont bien sombres, les têtes pâles sont plus pâles, sous ce beau ciel si bleu et si uni les guenilles sont bien plus déchirées ».
La Corse inspire bien d’autres belles réflexions à l’auteur, telles que celle-ci : « La misère dans le Nord n’a rien de bien choquant, le ciel est gris ; toute la nature est lugubre ; mais ici, quand le soleil répand tant de splendeur et de vie rayonnante, les couleurs sombres sont bien sombres, les têtes pâles sont plus pâles, sous ce beau ciel si bleu et si uni les guenilles sont bien plus déchirées ».
Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin : « C’était fini du Midi ! À Marseille il faisait froid, tout se rembrunissait et sentait déjà le retour ». Les dernières pages du journal, particulièrement expressives, reflètent l’état d’esprit d’un jeune homme à la fois triste et plein d’espoir, qui se promet de repartir le plus vite possible vers d’autres contrées. Il verra l’Italie en 1845, l’Orient en 1849 et la Tunisie en 1858. C’est sur le site de l’ancienne Carthage qu’il commencera à mûrir Salammbô.
 De retour de Corse, il écrit le 14 novembre à Ernest Chevalier : « Je suis emmerdé d’être retourné dans un foutu pays où l’on ne voit pas plus de soleil dans l’air que de diamants au cul des pourceaux » Et plus loin « Ah ! Que je voudrais vivre en Espagne, en Italie ou même en Provence ! »
De retour de Corse, il écrit le 14 novembre à Ernest Chevalier : « Je suis emmerdé d’être retourné dans un foutu pays où l’on ne voit pas plus de soleil dans l’air que de diamants au cul des pourceaux » Et plus loin « Ah ! Que je voudrais vivre en Espagne, en Italie ou même en Provence ! »
Le jeune Flaubert est plus mélancolique que jamais. Il faut dire que c’est pendant ce voyage, à Marseille, qu’il semble avoir vécu sa première aventure amoureuse, brève et marquante, avec cette belle Eulalie qu’il ne revit jamais. Et puis Flaubert devint Flaubert…
Lire en ligne « Par les champs et par les grèves » - cliquez ici
Une édition récente, en format poche, cliquez ici
 Déjà publiés
Déjà publiés
Jean-Louis Curtis et Les Forêts de la nuit - cliquez ici
Stendhal et son Voyage dans le Midi – cliquez ici
- Angelo de Sorr et Les Pinadas – cliquez ici
- Francis Jammes et Pipe, chien – cliquez ici






Réagissez à cet article
Vous devez être connecté(e) pour poster un commentaire