La France souffre d’un mal discret mais profond : la disparition progressive de races locales capables de s’adapter aux conditions climatiques, aux sols pauvres ou aux modèles d’éco-pâturage. Le mouton landais, autrefois souverain des prairies sableuses des Landes et de la Gascogne, avait silencieusement disparu. Pourtant aujourd’hui, cette brebis robuste, connaît une renaissance à bas bruit, portée par des éleveurs passionnés et des collectivités soucieuses de réinjecter un peu de ruralité utile dans le territoire.
La brebis landaise puise ses racines dans les sols sablonneux entre Garonne et Pyrénées. Elle a longtemps façonné l’économie modeste des Landes grâce à sa viande, sa laine dense et son fumier indispensable à la terre pauvre. Les bergers y travaillaient juchés sur leurs échasses, veillant leur troupeau dans les marais. Quand les forêts furent replantées sous Napoléon III, un reboisement massif mit fin à l’ère des prairies et des centaines de milliers de moutons furent rayés de la carte pastorale. Au milieu du XXᵉ siècle, la race frôlait l’extinction.
Mouton menacé, brebis sauvée
C’est en 1975 que le Conservatoire des races d’Aquitaine lance un plan de sauvetage. Grâce à des éleveurs déterminés, la race renaît de ses cendres et atteint aujourd’hui environ 3 000 têtes, réparties dans les Landes, le Lot-et-Garonne, la Gironde ou le Gers. Une victoire sur la spéculation forestière et l’industrialisation agricole. Le mouton landais est désormais toujours classé à faible effectif, mais il tolère mieux les chaleurs extrêmes, les sols dégradés, les hivers pluvieux. Sa petite taille, sa toison variée et endurante et sa robustesse sont de véritables atouts à l’heure du réchauffement climatique.
Sa laine, dense mais difficile à tisser, est aujourd’hui réemployée comme isolant ou pour le paillage. Elle est tonte annuelle, avant les chaleurs estivales. Apte à se débrouiller sur une végétation pauvre ou broussailleuse, ce mouton aide à prévenir les incendies et entretenir les espaces fragiles, sans machine ni intrant.
Aujourd’hui, le retour du mouton landais dans les prairies de France se fait par l’écopâturage. Collectivités, domaines agricoles, entreprises environnementales redécouvrent cette race comme outil écologique. Limiter la prolifération des broussailles, freiner le risque incendie, nourrir les sols, tout cela sans tracteur ni produit chimique. Un vrai bienfait territorial.
Du patrimoine à l’assiette
Si cette race n’investit plus le grand tissage, elle revient néanmoins dans les assiettes locales via des circuits courts. La viande, bien que de petite taille et au rendement modéré, offre une finesse de goût recherchée en bouche, notamment pour des recettes oubliées comme le panturon. Des initiatives locales permettent d’en retrouver la saveur originale, sur des marchés ou dans des boucheries régionales.
Dans la Gascogne profonde, l’éleveur Jean-Pierre Tintané tient le flambeau depuis une décennie. Il incarne cette prise de conscience. Et pour lui, chaque agneau vendu localement est un pas vers la reconnaissance du mouton landais comme un patrimoine vivant.
Car derrière chaque mouton landais se perçoit un écho culturel : celui des bergers échassiers, de la laine parfumée, des traditions pastorales résilientes. La réimplantation de cette race témoigne d’un territoire qui choisit de retrouver son rythme naturel : brouter, respirer, vivre avec la nature plutôt que contre elle. Le mouton landais devient alors un symbole de résilience écologique et de sauvegarde d’une humanité rurale.
Réhabiliter l’authenticité
Faire vivre cette race, c’est rétablir un pont entre la tradition et l’avenir, entre le pâturage et la gastronomie, entre la biodiversité et l’économie sensible. Elle rappelle qu’un simple mouton peut porter une histoire, un paysage, des besoins locaux. Elle affirme que certaines races lointaines ne sont pas sourdes à nos enjeux actuels.
De la Garonne aux Pyrénées, en passant par les Landes, le mouton landais trace à nouveau son chemin. Avec quelques milliers de têtes, il contribue à préserver un écosystème en équilibre fragile. Mais il ne s’agit plus seulement de le protéger : il s’agit de lui rendre toute sa place achevée dans les pâtures, les laboratoires d’écopâturage, et même sur nos tables.
Sébastien Soumagnas
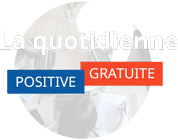



Réagissez à cet article
Vous devez être connecté(e) pour poster un commentaire