L'urgence de la décarbonation industrielle est une réalité prégnante tant en France qu'à l'échelle mondiale. En 2022, l'industrie française était responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre (GES), soulignant le rôle crucial de ce secteur dans la lutte contre le changement climatique et la nécessité d'initiatives ambitieuses pour inverser cette tendance.
C'est dans ce contexte que s'inscrit la démarche « Zones Industrielles Bas Carbone » (ZIBAC), une stratégie clé du plan d'investissement France 2030 visant à accélérer la décarbonation du secteur industriel. Lancé initialement en 2022, avec une clôture des appels à projets en mai 2023, ce programme pourrait être renouvelé sous conditions, témoignant de la volonté gouvernementale de soutenir durablement cette transition.
L'objectif fondamental de la démarche ZIBAC est d'accompagner les territoires industriels dans leur transformation écologique et énergétique afin d'accroître leur compétitivité et leur attractivité.
En voulant conjuguer durabilité environnementale et prospérité économique, la démarche ZIBAC repose sur des principes clés, notamment la définition de trajectoires de décarbonation ambitieuses à horizon 2030 et 2050.
Plusieurs régions en France ont déjà initié des projets concrets dans le cadre de la démarche ZIBAC. Riche d'une longue histoire industrielle marquée par l'exploitation du gisement de gaz naturel et le développement d'un important pôle chimique, le Bassin de Lacq est aujourd'hui au cœur de cette dynamique pour construire un avenir plus durable.
Dès 2003, face au déclin de l'activité gazière, le Groupement d'Intérêt Public (GIP) Chemparc a vu le jour, réunissant industriels, chercheurs et collectivités territoriales pour assurer la reconversion du territoire vers des matériaux innovants, les énergies propres et la chimie verte. Cette tradition d'adaptation et d'innovation constitue un atout majeur pour l'engagement du Bassin de Lacq dans la démarche ZIBAC.
La transition vers une zone industrielle bas carbone au Bassin de Lacq engendre des enjeux significatifs sur les plans économique, environnemental et social. Sur le plan économique, cette démarche offre le potentiel d'accroître la compétitivité et l'attractivité du territoire pour les entreprises. Ce processus de transition favorise également l'innovation et le développement technologique, tout en attirant des investissements dans des infrastructures et des technologies durables.
Mais au-delà des enjeux économiques et environnementaux, les enjeux sociaux de cette transition sont tout aussi importants : une amélioration de la qualité de vie des habitants est attendue grâce à un environnement plus sain.
Lacq en mode bas carbone
Lauréat de l'appel à projets ZIBAC grâce à son programme « LACQ iz. BACarbone », le site industriel vise la réduction des émissions de carbone et la promotion des activités qui privilégient cette décarbonation, ainsi que sur la production d'énergies renouvelables.
Lancé officiellement jeudi 10 avril, par le GIP Chemparc, le programme « LACQ iz. BACarbone » a permis la création d’une une feuille de route territoriale et intersectorielle de décarbonation, fixant des objectifs collectifs pour 2030 et 2050, alignés sur la stratégie nationale.
Ce dernier prévoit une approche structurée en deux phases. La première, dite phase de « Maturation », d'une durée maximale de 24 mois, est axée sur la réalisation d'études approfondies et la planification de la feuille de route de décarbonation.
La seconde phase, de « Soutien », d'une durée prévue de 5 à 10 ans, se concentrera sur la mise en œuvre et le suivi des projets identifiés lors de la phase initiale, nécessitant un nouveau dépôt de candidature pour obtenir des financements complémentaires.
Les études menées dans le cadre de la phase de Maturation sont organisées en sept blocs thématiques couvrant l'ensemble des aspects de la décarbonation : gouvernance et stratégie, énergies bas carbone, valorisations et optimisations des flux, gestion du CO2, gestion de l'eau, infrastructures et trajectoires de décarbonation.
Parmi les initiatives concrètes, le projet BioTJet se distingue comme un investissement majeur dans la production de carburant d'aviation durable à partir de biomasse et d'hydrogène bas carbone.
Ce projet, fruit d'une collaboration entre IFPEN, Axens, Elyse Energy, Avril et Bionext, prévoit une capacité de production de 75.000 tonnes de carburant d'aviation durable et 35.000 tonnes de naphta d'ici 2028, contribuant significativement à la décarbonation du transport aérien. Pour ce faire, un milliard d'euros seront investis dans ce projet, qui prévoit également la création de 800 emplois directs et indirects.
Par ailleurs, la société SOBEGI a engagé un projet de construction d'une nouvelle unité de production de vapeur décarbonée utilisant des déchets de bois comme combustible. Cette initiative permettra à l’entreprise de réduire ses émissions de CO2 de près de 60% d'ici 2030, tout en répondant aux besoins de ses clients.
Un projet collectif aux multiples défis
Le Groupement d'Intérêt Public (GIP) Chemparc joue un rôle central dans la coordination du programme « LACQ iz. BACarbone », en partenariat étroit avec les entreprises industrielles et les collectivités territoriales. Chemparc a notamment piloté le processus de candidature à l'appel à projets ZIBAC, agissant comme un facilitateur essentiel pour mobiliser et structurer les efforts des différents acteurs.
Parmi les entreprises industrielles clés impliquées dans cette initiative au sein du Bassin de Lacq, on peut citer Arkema, qui a déjà mis en œuvre un nouveau procédé innovant sur son site de Lacq/Mourenx permettant de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28%. D'autres acteurs majeurs tels que TotalEnergies sont également engagés dans la démarche, ayant même présenté une candidature commune et complémentaire avec la Communauté de Communes Lacq-Orthez.
La Communauté de Communes Lacq-Orthez joue un rôle de soutien essentiel en matière de planification stratégique et de potentielle contribution financière à l'initiative. Des institutions de recherche comme l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA), à travers son projet I-SITE E2S, apportent également leur expertise et leur capacité d'innovation aux efforts de décarbonation.
En outre, des organisations professionnelles et des pôles de compétitivité contribuent à animer et à structurer la démarche ZIBAC au sein du Bassin de Lacq. L'implication d'un écosystème aussi diversifié témoigne d'une volonté collective de mener à bien cette transition vers un modèle industriel bas carbone.
La réussite de la démarche ZIBAC au Bassin de Lacq sera conditionnée par la capacité du collectif à surmonter plusieurs obstacles et défis. Sur le plan économique, les coûts d'investissement initiaux pour l'adoption de nouvelles technologies et la mise en place d'infrastructures représentent un défi majeur.
Il est crucial de combiner viabilité économique et compétitivité des entreprises pendant cette transition. Les impacts potentiels sur l'emploi dans les industries à forte intensité carbonique nécessiteront des efforts de formation et de requalification de la main-d'œuvre. Dans le contexte économique et géopolitique actuel, l'obtention de financements suffisants pour soutenir les différents projets constitue un réel défis.
Sur le plan environnemental, les défis liés à la mise en œuvre de nouvelles technologies de décarbonation sont autrement plus techniques. La durabilité de l'approvisionnement en biomasse pour la production de biocarburants et les questions de disponibilité de l'eau pour les processus industriels pourraient constituer un frein majeur pour certains projets.
Ce qui nous amène au dernier grand défis de ce programme : l'acceptation du public pour les nouveaux projets industriels et les infrastructures, en particulier ceux liés au stockage de CO2 ou à l'hydrogène, sera déterminante.
Noémie Besnard
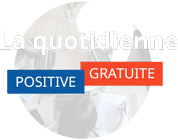


 PresseLib'
PresseLib'

Réagissez à cet article
Vous devez être connecté(e) pour poster un commentaire