La petite fromagerie d’Hélette s’est imposée comme la référence de l’AOP Ossau-Iraty, tout en devenant une société multiactivités avec 8 sites de production, dont 2 en Pays Basque Sud. 44 ans de visions et d’inspirations.
Née en 1981, la société s’est rapidement dotée d’une deuxième compétence dans la construction métallique. Elle a depuis fait l’acquisition de savoir-faire complémentaires dans les domaines de la charcuterie, de la pâtisserie et, plus récemment, du chocolat.
Au-delà, Peio Etxeleku (50 ans et père de 5 enfants) veut contribuer à apporter une vision ambitieuse sur le territoire, en fédérant les énergies autour de modèles agricole et économique plus durables et plus résilients, compatibles avec les enjeux planétaires. Cela en visant la régénération du vivant.
Vous êtes un homme aux fortes convictions. Comment s’est forgée votre personnalité ?
Peio Etxeleku – Elle a été particulièrement marquée par la langue basque et ma basquitude. Mes parents m’ont transmis cela dès le plus jeune âge. Je fais partie des premiers élèves d’une ikastola. J’ai ancré au fond de moi un attachement identitaire et territorial puissant, avec une identité que je considère devant être ouverte et inclusive. Je me suis construit à partir et autour de ces racines profondes. Mes parents, dans des domaines différents, ont été une source d’inspiration majeure. Avec aussi un engagement pour cette agriculture de montagne, qui représente un trait caractéristique essentiel du Pays Basque intérieur. J’ai beaucoup appris de ma mère, Margitta, qui a porté à bout de bras le projet d’un lycée en milieu rural, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Elle a dirigé l’établissement pendant 30 ans et l’a sauvegardé. C’était aussi une entrepreneuse remarquable, dans son secteur, avec son style.
Et Jean, votre père ?
P. E. - L’âge avance, je viens de me rendre compte que je ne suis qu’à trois ans de l’âge de mon père quand je l’ai rejoint. Il a créé sa première entreprise l’année de ma naissance, une coopérative. Il disait que l’entreprise était son bébé, alors je considère qu’elle est ma petite sœur [large sourire]. Quand il a créé Agour, j’avais 7 ans. Je m’en souviens parfaitement. Je l’ai vu avec toute son audace, toute son abnégation, avec cette résilience extraordinaire qui fait que chaque obstacle était pour lui une opportunité pour rebondir. Peu de choses lui faisaient peur, pour ne pas dire rien. En plus de sa force de travail, il avait une capacité remarquable à être un leader très inspirant, à emporter avec lui les équipes de salariés, à mobiliser les paysans en les amenant à croire ensemble dans un projet… Avec rien, avec une énorme volonté, et quelques coups de génie visionnaires, il a réussi à bâtir quelque chose de solide et qui porte sens pour notre territoire.
Fromager et bâtisseur ?
P. E. - Son premier métier, c’était le fromage. En 1981, il démarre la transformation du lait de brebis apporté par une trentaine d’éleveurs. Très rapidement, mon père propose à ceux qui le souhaitent du matériel et des machines pour produire le lait. Mais aussi, de leur construire les bâtiments nécessaires, clés en main. Dans les années 1980, les fermes étaient en pleine évolution, avec la zone d’élevage qui sortait de la partie habitation. Il fallait donc construire à côté du corps de ferme. Il a voulu apporter des solutions techniques à ses producteurs auxquels il achetait le lait. Une sorte d’économie circulaire qui prenait tout son sens. Il est devenu charpentier métallique en deux ans parce qu’il fallait absolument répondre au besoin d’étables et de bergeries. Cela sans connaître le métier, avec simplement un certificat d’études.
Vous poursuivez cette activité ?
P. E. – Oui. Mais à partir des années 1990, l’activité élevage s’est progressivement estompé. Alors, nous avons fait une bifurcation de notre modèle économique de charpentier métallique pour le monde agricole, en allant vers des bâtiments industriels et commerciaux, de tous types que ce soit pour le public ou le privé. Nous avons ensuite fait l’acquisition de la société Bessonart, aux portes de Bayonne qui nous a permis de franchir un nouveau cap.
Notre moteur à deux temps fonctionnait merveilleusement bien
Quand avez-vous décidé de rejoindre votre père dans cette aventure ?
P. E. – En fait, dès l’âge de 16 ans, c’était à peu près clair dans ma tête. Je ressentais à quel point cette aventure familiale pouvait permettre d’apporter à ce territoire que nous chérissons, des capacités économiques pour être davantage souverain, pour mieux se prendre en main, pour assurer la pérennité d’un modèle agricole. Et, derrière, pour favoriser la pérennité d’une structure sociétale, la société du Pays Basque intérieur, qui fait notre fierté et notre différence.
Vous vous êtes formé en conséquence ?
P. E. – Cette perspective a guidé mon parcours d’études et mes premiers pas dans le milieu professionnel. J’ai intégré une école de commerce à Paris, l’Essec, et puis je suis rentré dans un très gros cabinet de conseil et d’audit, EY (Ernst and Young à l’époque), dans l’équipe de consultants aux fournisseurs de produits de grande consommation. C’était prémédité. Cela me permettait d’intégrer plus facilement encore les codes et les paramètres de ces marchés.
Loin d’Hélette…
P. E. – Pendant toute cette période, j’avais un contact quotidien avec mon père sur la marche de l’entreprise, sur les décisions stratégiques à prendre. Je participais déjà à des recrutements, je m’imprégnais d’un maximum de choses. Une opportunité a fait que je suis revenu plus tôt que prévu, alors que j’aurais voulu avoir un peu plus d’expérience à l’international, notamment. Vis à vis de toute l’équipe, je ne voulais pas être seulement le fils de… mais arriver avec une valeur ajoutée.
Comment a fonctionné votre duo à la tête d’Agour ?
P. E. – À ses côtés, j’ai vécu une aventure familiale et professionnelle extraordinaire, avec une relation extrêmement forte, totalement fluide et de confiance. Ce moteur à deux temps fonctionnait merveilleusement bien. De mon arrivée, le 1er janvier 2001, jusqu’au 17 juillet 2012, date malheureuse de son décès très brutal, l’entreprise a connu un développement spectaculaire : la fromagerie a multiplié sa taille par 5 ou 6, et nous avons créé une unité de transformation à Iraty ; l’activité construction a été doublée avec l’acquisition de la société Bessonart ; nous avons réussi à convaincre de nouveaux agriculteurs de rejoindre l’aventure. Lors de ces 12 années, nous avons fait des sauts qualitatifs importants au niveau de la fromagerie, et nous avons commencé l’internationalisation de nos marchés. Dans les derniers mois de la vie de mon père, nous avons lancé ensemble une gamme qui sera déterminante dans l’histoire de l’entreprise : une gamme de glaces au lait de brebis. Quand on met un doigt dans la glace, on met un bout de son bras dans le monde extraordinaire de la pâtisserie.
Dur de continuer sans votre père ?
P. E. – Il nous a fallu un an et demi pour absorber le choc : j’avais perdu un père biologique, l’entreprise et sa centaine de collaborateurs étaient aussi orphelines. C’était comme si on m’avait enlevé mon GPS, mes roues arrières… Après cette période délicate, nous avons constaté que nous avions plutôt bien surmonté l’épreuve. Ce qui nous a permis d’envisager une stratégie de développement importante. Avec mon équipe, on a fait le pari de changer de braquet, de changer de dimension d’entreprise et de nous lancer dans la croissance externe de façon ambitieuse. C’était aussi nécessaire pour pouvoir me structurer avec une équipe de management avec laquelle je pourrai partager le projet. Il fallait faire en sorte que le pilotage de l’entreprise soit moins dépendant d’une ou deux personnes. J’avais mesuré les fragilités potentielles. Nous avons fait le pari du collectif et d’une certaine taille, toujours au service du territoire.
Le développement de l’activité pâtisserie est tellement puissant…
Vos principales acquisitions ?
P. E. - En 2014, on a repris trois entités sur deux marchés différents : l’une dans la pâtisserie au Pays Basque Sud, avec Casa Eceiza à Tolosa, et deux autres dans la charcuterie, en Béarn et en Chalosse. Cela en se donnant les moyens d’assurer un pilotage habile et efficace de l’ensemble. Malheureusement, l’activité charcuterie a beaucoup souffert, de quelques erreurs internes, mais aussi d’un marché qui est extraordinairement complexe, concurrentiel et en régression. Résultat, ce secteur ne génère pas la valeur ajoutée indispensable. Il faut dire que la charcuterie a une image en demi-teinte : un produit emblématique et symbolisant la convivialité, mais auquel on donne souvent une note négative à la fois sur le plan nutritionnel, au niveau système d’élevage et de la santé animale… La charcuterie n’est plus dans les tendances sociétales.
La concurrence est forte…
P. E. – Très, et c’est perturbant. Nous faisons face à des concurrences espagnoles (surtout) et italiennes, avec des systèmes de production beaucoup plus industrialisés que nous. Ils bénéficient d’une image positive aux yeux du consommateur, parce que ce sont les deux terroirs les plus réputés en matière de charcuteries dans le monde. De plus, le rapport qualité-prix nous met un peu hors marché. Parallèlement, l’IGP Jambon de Bayonne, qui devait tirer la filière vers le haut, souffre d’être devenu le jambon standard français. Difficile avec cela de défendre nos marges.
Par contre, la pâtisserie s’avère être un choix judicieux…
P. E. – Le développement est spectaculaire, grâce à une équipe soudée, efficace, parfaitement alignée avec la stratégie. Cette activité s’appuie sur beaucoup d’innovation : nous renouvelons nos gammes au rythme de 30% à 40% tous les ans. C’est considérable. Nous sommes dans une logique de développement produits qui s’approche de la mode. Le succès repose sur beaucoup d’agilité commerciale, nous sommes présents sur tous les circuits en Espagne, avec un capital de marque très puissant qui nous permet aussi d’avoir une bonne valorisation.
C’est cette réussite qui vous a conduit vers le chocolat ?
P. E. – Le développement de l’activité pâtisserie est tellement puissant qu’on s’était donné l’ambition de faire une opération de croissance externe, côté français, pour aller chercher plus de synergies encore au point de vue industriel et commercial. Nous étions en veille active, lorsque la famille Andrieu, une famille amie de longue date, nous a interrogé pour savoir si nous serions intéressés par la reprise des Ateliers du chocolat à Bayonne. C’était il y a un peu plus d’un an. Nous avons considéré que cela avait du sens pour accélérer notre activité pâtissière que ce soit au niveau de l’innovation produit, du développement des gammes, des modèles de distribution ou encore de la complémentarité des sites de production. En plus, nous sommes portés par les mêmes valeurs : cela fait 6 mois que l’on travaille ensemble et l’on a l’impression de se connaître depuis 15 ans. Le mayonnaise prend très bien et nous allons enclencher un développement stratégique sur de nombreux axes. C’est très enthousiasmant !
Une entreprise et un territoire plus durables, résilients et ouverts sur le Sud…
Quelle vision pour l’évolution du groupe ?
P. E. – Nous sommes sur des multifamilles agroalimentaires, avec la volonté de nous appuyer sur des produits iconiques du territoire. Avec une tradition d’innovation, comme moteur de notre développement. A partir de là, nous souhaitons prendre une orientation forte vers la durabilité. Ainsi, nous avons participé à une démarche très ambitieuse : la Convention des Entreprises pour le Climat qui consiste à revisiter complètement nos modèles économiques pour les rendre compatibles avec les enjeux planétaires et viser la régénération du vivant. C’est d’autant plus important qu’on est sur des métiers en prise directe avec cela. Notre ambition est d’être fédérateur du modèle agricole basque pour le rendre plus pérenne et plus résilient.
Quelles initiatives dans ce sens ?
P. E. - Les 4 ou 5 années prochaines vont être marquées par les premiers pas d’une bifurcation assez importante de notre modèle économique en tant qu’entreprise, mais aussi du modèle économique de nos fournisseurs de lait, notamment. Le foisonnement d’idées est en cours, par exemple au niveau des productions végétales, des énergies renouvelables, etc. On observe beaucoup ce qui se passe, on est en train de constituer un réseau d’experts et de connaissances pour alimenter nos réflexions. C’est dans cet esprit que nous avons créé l’incubateur Hazitegia, pour faire venir à nous des entreprises du numérique, des startups fortement innovantes, mais aussi des projets très engagés dans la transition écologique.
Comment s’inscrivent vos autres engagements ?
P. E. – J’ai un engagement politique personnel très ancien. Mon parcours économique entrepreneurial permet d’accroître la crédibilité du discours. Je suis élu municipal depuis 2014, mais je me suis impliqué plus fortement en 2020 avec la volonté d’influer de l’intérieur sur le premier outil institutionnel constitué depuis la Révolution : la Communauté Pays Basque. Mon objectif est de pouvoir orienter la vision stratégique du territoire vers plus de rééquilibrage, vers le développement d’activités économiques le rendant plus résilient, moins dépendant de certains secteurs, assurant sa bifurcation écologique…
Vous êtes impliqué dans des instances du Pays Basque Sud ?
P. E. – Agour fait partie des très rares entreprises vraiment transfrontalières, avec 40% de nos activités en Gipuzkoa. Avec notre connaissance très pointue de l’écosystème économique et politique du Sud, nous mesurons à quel point le Pays Basque Nord pourrait tirer profit de coopérations au niveau de projets d’enseignement, de formation, d’innovation, de développement industriel, d’activités commerciales à l’international, d’investissements dans le numérique et l’intelligence artificielle (IA). Pour tous les grands défis économiques auxquels nous sommes confrontés, comme toutes les régions du monde, nous sommes trop petits. Nous avons beaucoup à gagner d’un rapprochement avec leur potentialité et leur culture économique industrielle qui est extraordinaire. Avec en plus, la puissance que leur donne un niveau d’autonomie politique des plus développés en Europe, pour orienter très fortement et de façon très réactive la stratégie économique de leur territoire. J’ai la chance d’être associé aux stratégies d’internationalisation du Gouvernement basque, de la réflexion initiale jusqu’à son déploiement complet. La participation à l’économie d’Hegoalde fait qu’on connaît rapidement tous les décodeurs politiques et économiques. Il y a une grande fluidité d’échanges, de réflexions et d’actions.
Que préconisez-vous d’autre ?
P. E. – La Communauté basque, si elle mobilisait ses ressources plutôt dans des projets structurants que vers l’augmentation non maîtrisée des charges de fonctionnement, pourrait avoir un effet bénéfique plus fort sur le territoire. L’action publique devrait être portée par une vision à 25 ans, plutôt que d’être dictée par la prochaine échéance électorale. Je trouve aussi que les cultures managériales et de pilotage, les cultures de délégation et de confiance envers les équipes, se sont très fortement différenciées entre la sphère publique et la sphère privée. Aujourd’hui, dans un monde ouvert, extrêmement changeant, bouleversé à la fois par la révolution numérique, l’ouverture des marchés, les chocs multiples (écologique, sanitaire, géopolitique…), nous devons avoir une capacité d’adaptation extraordinaire. La façon de gérer l’entreprise aujourd’hui n’a rien à voir avec celle pratiquée il y a une douzaine d’années. Nous avons gagné en agilité, avec des équipes très autonomes, très opportunistes… Toute entreprise sait qu’elle est mortelle. Et l’on a bien conscience que, tous les jours, nous devons nous battre pour sa survie. Malheureusement, la sphère publique n’a pas procédé aux mêmes remises en cause. Il faut l’amener vers cette voie.
Informations sur le Groupe Agour, cliquez ici
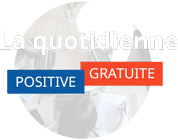





Réagissez à cet article
Vous devez être connecté(e) pour poster un commentaire