Pendant longtemps, tenter de produire de l’orge brassicole en Iparralde (Pays basque Nord) relevait presque de l’acharnement thérapeutique. Depuis 2014, plusieurs essais de semis ont été menés, mais tous se sont soldés par des récoltes affaiblies, des maladies avant maturité ou des difficultés de stockage et de maltage. Le diagnostic était sans appel : le territoire ne manquait pas de volonté, mais la filière manquait encore de structure, d’outils et de variétés adaptées.
Il a fallu un long protocole de “rééducation agricole” pour rétablir les équilibres. Années après années, les techniciens ont analysé les sols, testé de nouvelles variétés, ajusté les pratiques culturales et évalué minutieusement les résultats de maltage. Une démarche patiente, presque clinique, qui a permis d’identifier enfin les types d'orges les plus compatibles avec les terroirs du Pays basque Nord.
En 2025, ce travail de fond a permis un premier tournant : seize hectares ont été semés, marquant la première année réelle de production locale. Pour la filière, c’est un peu comme si la convalescence touchait à sa fin et que l’orge basque pouvait prendre son envol.
Un collectif pour redonner souffle à la filière
La création, en juillet 2025, de l’association Herriko Garagarnoa agit comme l’ouverture d’un service de coordination : paysans, malteries et brasseries locales s’y regroupent pour structurer la filière, définir ses besoins, assurer la qualité, répartir la valeur ajoutée et porter une marque collective. Objectif affiché : atteindre à terme 240 tonnes d’orge produites localement.
Cette organisation vient également répondre à un besoin de “prise en charge collective” du territoire. Les agriculteurs, conscients des limites de la monoculture du maïs et des pressions sur l’eau, cherchent à diversifier leurs cultures. Semer de l’orge, c’est introduire une rotation plus vertueuse, redonner souffle aux sols et inscrire leurs exploitations dans un avenir plus durable.
La plupart des producteurs impliqués se trouvent en Amikuze, mais la dynamique gagne d’autres zones, du Béarn à la Soule en passant par Irisarri. Un réseau qui ressemble de plus en plus à un maillage solidaire, où chaque exploitation contribue à la bonne santé d’ensemble.
La filière basque n’est pas née d’hier. En réalité, les premiers essais remontent à 2013, initiés par la Chambre d’Agriculture du Pays Basque. Douze ans plus tard, les avancées sont visibles : en 2022, un premier demi-hectare produit 1,8 tonne d’orge jugée maltable. En 2024, six hectares donnent huit tonnes. En 2025, dix-huit hectares permettent d’envisager trente tonnes.
L’année 2025 marque également la naissance de la première malterie du Pays Basque Nord, installée à Saint-Martin-d'Arberoue. Grâce à cet outil, la transformation peut désormais être intégralement réalisée en Iparralde. Le maltage y est opéré selon un procédé traditionnel : germination à même le sol, séchage contrôlé, torréfaction au four à bois. Trois malts classiques, à savoir Pils, Pale et Munich, y sont produits, offrant en retour une palette de possibilités à une scène brassicole déjà bien implantée.
Aujourd’hui, neuf brasseries locales utilisent ponctuellement ou régulièrement le malt Herriko. Chacune conserve évidemment son identité commerciale, mais peut désormais afficher la mention « Herriko Garagarnoa » sur les bières brassées à partir de cette orge locale.
Une filière pensée comme un service d’intérêt territorial
Au-delà de la production, l’association porte un véritable projet de gouvernance. Les membres s’attachent à définir un cahier des charges précis afin de garantir l’origine, la qualité et la cohérence de la filière.
Pour les agriculteurs, plusieurs règles encadrent la production : agriculture familiale, limite de surface à 10 hectares d’orge par exploitation, stockage de la récolte pendant 2,5 mois avant envoi en malterie. Les champs doivent être situés dans le Pays basque Nord ou les communes limitrophes. Une manière de s’assurer que la filière reste locale… au sens géographique comme au sens moral.
Les malteries doivent être implantées dans le Nord et ne travailler que de l’orge locale pour tout malt étiqueté comme tel. Quant aux moulins à orge, ils doivent eux aussi être situés dans le territoire et respecter des seuils stricts : 100 % de malts classiques issus d’orge locale, au moins 70 % pour les malts classiques au sens large, et un minimum de 50 % dans le cas de l’orge blanche.
Le houblon, faute de production locale suffisante, ne figure pas encore dans le cahier des charges. Mais ce manque, loin de fragiliser la dynamique, trace plutôt la feuille de route des prochaines années : étendre la filière et, à terme, rendre toute la chaîne brassicole plus résiliente et autonome.
Une aventure collective qui soigne le territoire
Si la filière orge/malt/bière du Pays basque a mis plus d’une décennie à émerger, c’est qu’elle s’est construite par étapes, sans brûler les cycles naturels ni les équilibres économiques. Elle est aujourd’hui portée par une véritable logique de solidarité, où chaque maillon, c'est-à-dire agriculteur, malteur et brasseur, joue sa part dans cet écosystème délicat.
En réintroduisant l’orge dans les rotations, en valorisant une matière première locale, en consolidant un savoir-faire artisanal et en partageant la valeur ajoutée de façon plus équitable, Herriko Garagarnoa répare un lien entre agriculture, économie et territoire. L'association redonne souffle à un paysage agricole en quête de diversité. Elle rassemble des acteurs qui, ensemble, ont choisi de construire un projet plus durable.
Sébastien Soumagnas
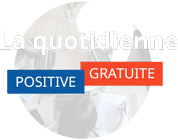





Réagissez à cet article
Vous devez être connecté(e) pour poster un commentaire